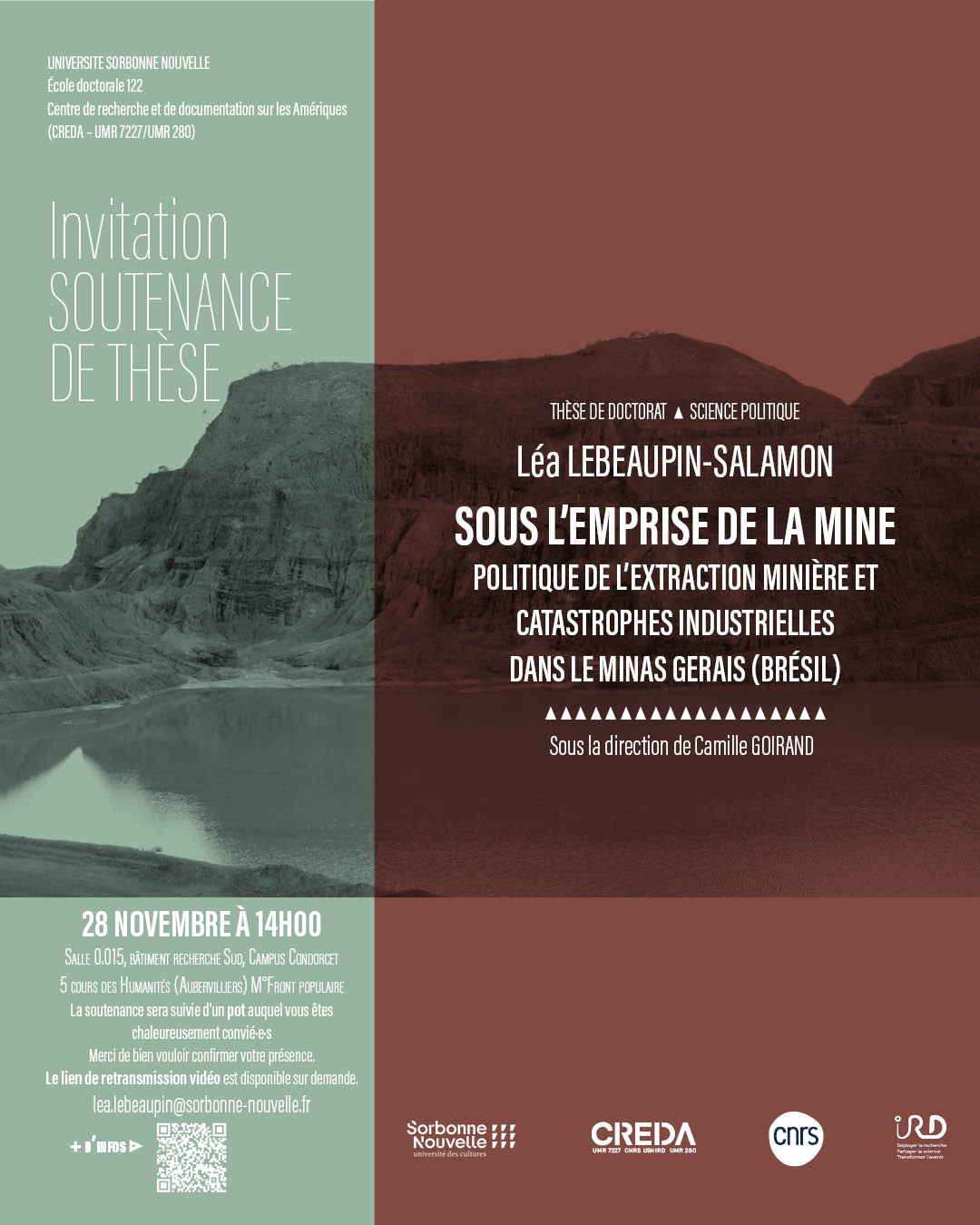Nous avons le plaisir de vous présenter Camille Riverti, chargée de recherche en anthropologie, arrivée au CREDA début janvier 2024.
Comment voulez-vous être présentée ?
La question de l’étiquette me pose quelques problèmes… Car on pourrait a priori me classer dans l’ « anthropologie linguistique » mais celle-ci a une histoire, notamment états-unienne, qui la distingue de l’ « anthropologie sociale ». Or dans mon cas il s’agit bien de faire de l’anthropologie sociale à partir des pratiques langagières ; et cela signifie apprendre les langues vernaculaires de façon poussée, ce qui est aujourd’hui possible grâce à l’existence d’instituts comme l’INALCO, conduire les enquêtes dans les langues locales et se poser la question de l’énonciation dans la pratique du terrain, puisqu’une part importante de notre travail consiste à parler avec les gens. Donc je dirais que je suis une anthropologue qui a appris une langue amérindienne, le quechua, qui travaille dans les Andes sud-centrales du Pérou et qui s’intéresse aux pratiques langagières comme tremplin pour penser le social.
Votre thèse portait sur les performances humoristiques et érotiques quechua. Pouvez-vous nous donner un aperçu des principales conclusions de votre recherche à ce sujet ?
Oui, il faut sans doute commencer par dire que je n’avais pas du tout prévu de travailler sur le sujet de l’humour érotique quechua mais que celui-ci s’est imposé lors du terrain. Je suis partie pour la première fois en 2015 dans une communauté paysanne de langue quechua, dans le département de Huancavelica (Pérou), et en fait les habitants de cette communauté ne cessaient de faire des blagues, tout le temps. Des blagues qui me prenaient d’ailleurs à parti personnellement, et qui ne ressemblaient pas à celles qu’on connaît ici, puisqu’il s’agissait de mettre en jeu les rapports d’alliance, comme dans un petit théâtre improvisé : on jouait à être « futurs époux », « future belle-mère » et « bru », selon les rôles fictifs attribués à chacun durant l’interaction. Ce que je suis arrivé à dire de ces performances humoristiques, c’est qu’il s’agissait là d’un « parler parodique » qui faisait office, localement, de ressource de réflexivité et de support au dire. Ressource de réflexivité car la performance burlesque était la forme par laquelle les gens de ces communautés réfléchissaient au fond à ce qui les fait tenir ensemble, les rapports d’alliance. Et support au dire car c’était aussi le cadre interactionnel par lequel les femmes, en particulier, s’autorisaient à parler dans l’espace public de certains aspects violents des rapports conjugaux, comme les violences conjugales, l’alcoolisme des époux ou les adultères, voire à les critiquer de façon déguisée.
Vous mentionnez le concept d' »alliance burlesque » dans vos travaux. Pourriez-vous expliquer en quoi consiste cette notion et comment elle est liée à votre recherche ?
C’est en effet une notion que j’ai introduite dans un article publié l’année dernière dans L’Homme (« Un veuf et une ethnographe. L’alliance burlesque dans les Andes »). J’essaie de montrer qu’il est plus pertinent, dans le cas andin et selon une approche pragmatique attentive aux situations d’énonciation, de parler d’ « alliance burlesque » plutôt que « parenté à plaisanterie », qui est la formule classique de l’anthropologie structuro-fonctionnaliste. Ceci pour au moins deux raisons. D’abord, car la formule « alliance burlesque » met l’accent sur ce que les gens font durant ces interactions, à savoir tourner en dérision les rapports d’alliance. Ensuite, car la formule visibilise le registre burlesque qui est plus juste que le terme « plaisanterie », et donne à voir la portée politique de ce parler. Chez mes interlocuteurs, ce registre est très clairement identifié comme una « burla », une farce.
Qu’est-ce qui vous a poussé à étudier l’humour et l’érotisme au Pérou ?
Comme je le disais, cet humour érotique est quelque chose qui a émergé de l’ethnographie. Ce qui a achevé de me convaincre d’en faire un sujet d’étude c’est avant tout le caractère répétitif, presque systématique, de cette pratique verbale dans des contextes sociaux extrêmement variés. Puisque les gens « parlent burlesque » autant au marché du dimanche que durant les fêtes, les funérailles, les assemblées… Et même si ce registre burlesque m’était souvent adressé, car en tant que jeune fille étrangère blanche et célibataire je réunissais un certain nombre de caractéristiques qui faisaient de moi une cible burlesque idéale, je voyais bien qu’il s’agissait d’un registre répandu, que les gens connaissaient très bien et à propos duquel ils avaient des opinions, assez contrastées d’ailleurs. Ensuite, il y avait aussi la figure assez intrigante de la « souffleuse » qui était généralement une femme qui soufflait ou répétait les répliques des uns et des autres, et qui me permettait précisément de prendre part au burlesque : une sorte de passeuse de parole. Un dernier élément est sans doute la langue, car ces pratiques se faisaient presque exclusivement en quechua, que j’avais appris à l’INALCO avant de partir sur le terrain, et ceci a retenu mon attention puisque les habitants de la communauté paysanne où j’ai travaillé étaient en majorité bilingues quechua-espagnol.
Votre parcours tendait-il toujours vers ce champ d’étude ?
Non, je dirais plutôt que mon parcours est fait d’à-coup et de zigzags et que la cohérence n’apparaît qu’après-coup, lorsqu’on se retourne pour examiner le passé. Mais, plus que la question de l’humour, je dirais que c’est celle de l’énonciation et, en particulier, de l’énonciation des violences de genre – l’humour burlesque n’en étant qu’un cas – qui m’apparait aujourd’hui comme étant la ligne qui se dégage de mes recherches. Aujourd’hui je m’intéresse à l’énonciation des violences obstétricales, en travaillant notamment avec les femmes et les hommes de langue quechua qui ont été stérilisés de force dans les années 1990, dans le cadre d’une politique publique péruvienne.
Quel objectif aviez-vous en vous intéressant premièrement aux sociétés Quechua ?
On le sait, la recherche en sciences sociales est souvent motivée par quelque chose de très personnel… Didier Eribon le montre très bien dans son Retour à Reims. Dans mon cas, une partie de la réponse tient sans doute à l’histoire de migration de ma famille, qui a quitté l’Argentine durant les dernières années de la dictature : il s’agissait de retourner aux Amériques, et peut-être aussi d’essayer de comprendre le continent. Le choix plus précis des sociétés de langue quechua s’est fait par la langue : j’ai d’abord cherché la langue amérindienne, qui me parlait et que j’allais être en mesure d’apprendre, et puis la langue m’a amenée aux gens.
Quelles évolutions avez-vous constatées au fil de vos recherches ?
Une évolution thématique semble se dégager assez clairement, puisque mes recherches ont d’abord porté sur le support écrit, précisément la littérature de fiction contemporaine quechua publiée au Pérou depuis une trentaine d’années. Puis, pour ma thèse, je suis passé de l’écrit à l’oral en conduisant l’étude d’une performance verbale quechua, l’alliance burlesque. Aujourd’hui, avec la question de la stérilisation forcée, je travaille sur des registres verbaux assez contrastés : d’une part, le témoignage, qui tend parfois à se rigidifier, d’autre part, les silences, les bribes et les formes de stigmatisation langagière qui sont d’ailleurs souvent burlesques.
Comment décririez-vous votre champ d’étude ?
C’est difficile de circonscrire ce champ en particulier car il est en mouvement mais je dirais qu’il se passe quelque chose depuis quelques années : on voit l’émergence des recherches ethnographiques sur les violences depuis langues amérindiennes. C’est en tout cas dans ce champ-là que j’inscrirais volontiers mes recherches.
Quelles sont vos méthodes de recherche ?
J’emprunte beaucoup à l’anthropologie linguistique puisque j’enregistre, je transcris, traduis et je suis très attentive aux situations d’énonciation. Je m’inspire aussi des études de genre, notamment de la question des savoirs situés qui rejoignent les réflexions en anthropologie sur la position de l’ethnographe et la réflexivité.
Comment envisagez-vous l’avenir de vos recherches et quels sont les domaines que vous aimeriez explorer à l’avenir ?
Alors la notion que je travaille, et que je veux développer dans les années à venir, est celle du « dicible ». Quelles sont les conditions de possibilité pour dire les violences ? Qui parle et avec quels moyens ? Et aussi : qui ne parle pas ? Ou encore : quelles sont les stratégies pour dire sans dire ? Par ailleurs, je m’interroge sur les manières de faire une anthropologie « avec » les gens du terrain ; en l’occurrence, « avec » les femmes qui ont été stérilisées de force dans les années 1990 et avec celles qui continuent à vivre des violences obstétricales aujourd’hui. Je m’interroge aussi sur les formes de publication et d’ouverture mes recherches à une audience large. Pour l’instant, mais la réflexion est en chemin, je m’oriente vers une anthropologie narrative, qui raconte plutôt qu’elle ne dissèque.
Comment envisagez-vous votre passage à I’IHEAL/CREDA ?
J’espère que ce ne sera pas qu’un passage, mais plutôt un ancrage. On verra !
Mot de la fin ?
Allinlla qamlla.