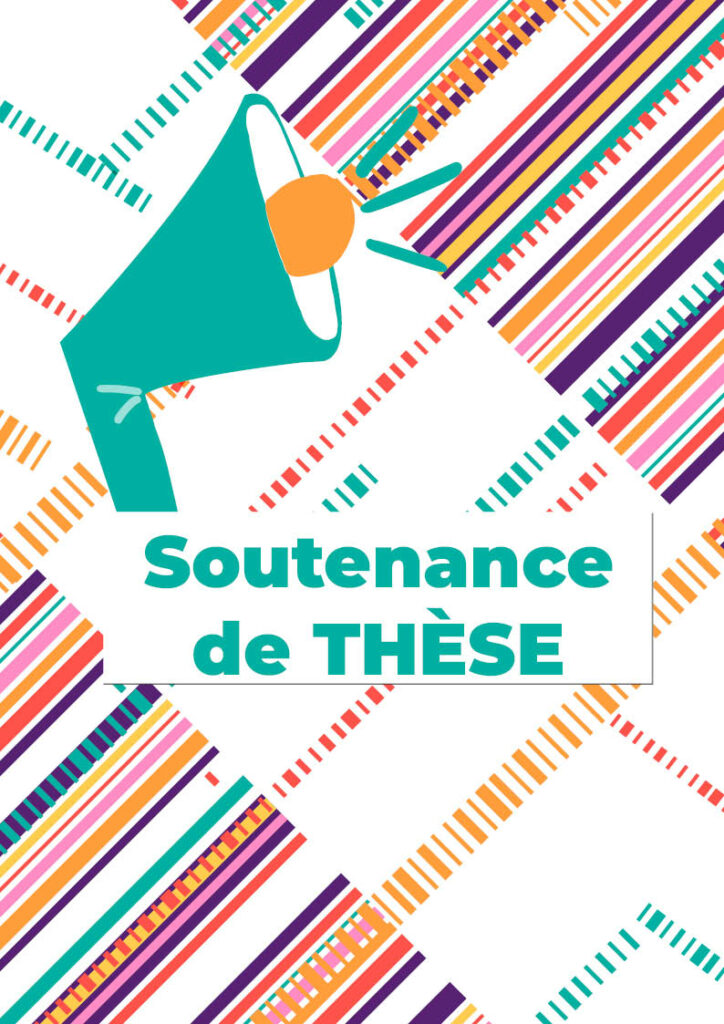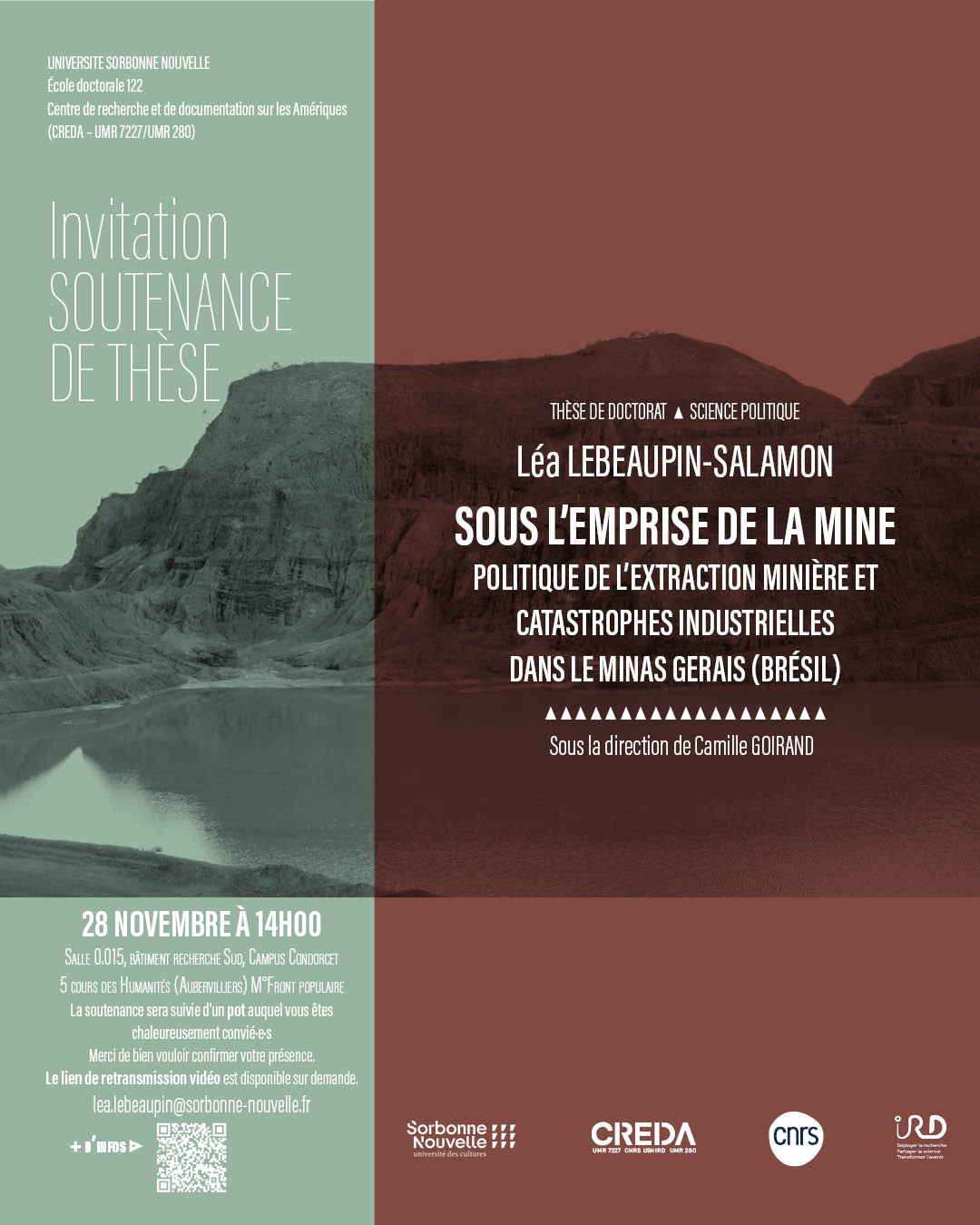Soutenance de thèse – Justine Berthod
📅 Vendredi 17 octobre 2025
🕒 14h – 18h
📍 Campus Condorcet, Bâtiment de recherche Sud, salle 0.033 (RDC)
Le CREDA (UMR 7227) a le plaisir d’annoncer la soutenance de thèse de Justine Berthod, préparée sous la direction de David Dumoulin intitulée :
De la terre à la mer, de la mer à la chair. Mettre en ordre et contenir les pollutions du plantationocène en Martinique : le chlordécone en mer
Résumé
Cette thèse contribue à la sociologie politique des environnements dégradés et pense l’inscription de la mer dans le plantationocène. En suivant la trajectoire et les modes d’existence d’un polluant persistant en mer – le chlordécone en Martinique – le travail d’analyse s’attache à saisir les tensions entre ce qui peut être vu, classé, gouverné, et ce qui est soustrait à la responsabilité politique. Elle s’appuie sur une démarche d’enquête ethnographique menée dans une variété d’espaces sociaux martiniquais, à la croisée des arènes du chlordécone et de la mer : les institutions de l’État et de la Collectivité, les scientifiques, les marins-pêcheurs et les initiatives citoyennes. Cette thèse montre d’abord l’extension en mer d’une « gouvernance résiduelle » limitée à la gestion des externalités sanitaires de la Plantation et la neutralisation des confits postcoloniaux, depuis la fabrique des zones d’interdiction de pêche. Elle expose ensuite l’empêchement de l’écologisation de cette pollution historique, depuis à la fois les mécanismes de production de l’ignorance générés par les sciences réglementaires, et les lignes de fracture d’une conservation marine en pleine recomposition face au chlordécone. Les interdictions de pêche redéfinissent les modes d’accaparement maritime, et par là même les figures de la transgression : de « braconniers » à « empoisonneurs ». En l’absence de dédommagement, la thèse montre comment les pêcheurs bricolent et négocient le maintien de leurs zones de pêche en dehors du périmètre des territoires sacrifiés. Enfin, elle met au jour les violences des promesses de dépollution, et explore les « altervies » et attachements citoyens aux milieux marins abîmés, révélant les tensions entre la gestion individualisée du risque et les expériences collectives d’une mer en marge du monde habité